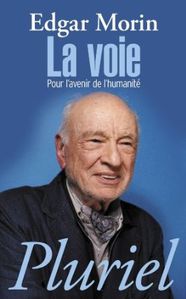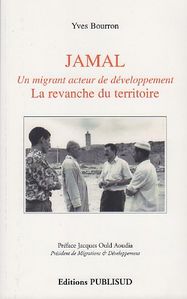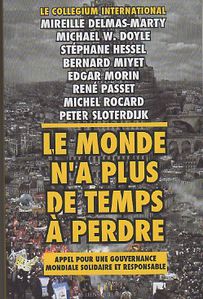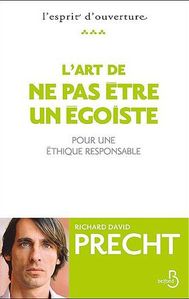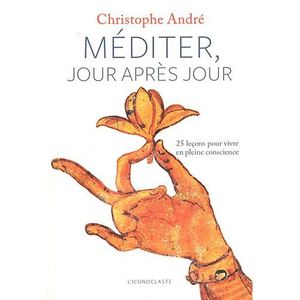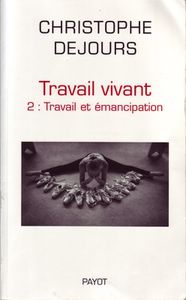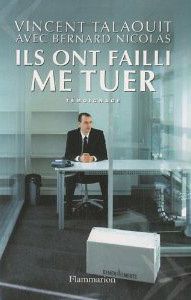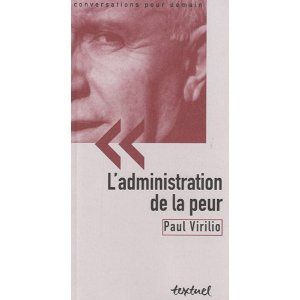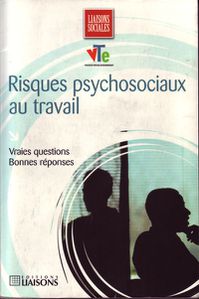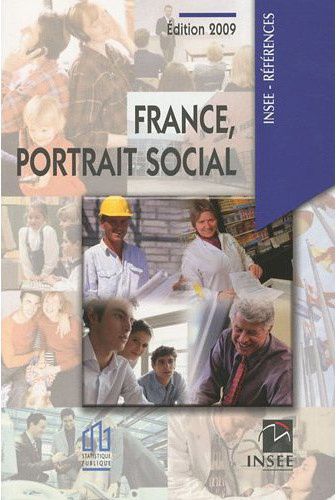Richard SENNETT
Richard SENNETT
Ensemble, pour une éthique de la coopération
Albin Michel, Paris, 2014, 378 p.
Richard Sennett est un des plus brillants sociologues contemporains. Il enseigne cette discipline à la New York University et à la London School of Economics et a publié une dizaine d’essais ainsi que trois romans. Cet ouvrage s’inscrit dans une trilogie consacrée à l’homo faber, dont il constitue le deuxième volet après Ce que sait la main, la culture de l’artisanat.
Abordant la coopération, Sennett note combien c’est la cité qui oblige à penser aux autres et à traiter avec eux mettant en jeu des « compétences dialogiques »,compétences fondatrices de l'intelligence collective sur laquelle nous fondons d'importants espoirs.
Dans le monde contemporain, elle subit le poids d’un contexte de plus en plus inégalitaire. En matière de travail, elle est aussi influencée par le court-termisme et le changement permanent qui engendrent des relations sociales superficielles et renforcent de l’effet silo. Ce faisant, « nous perdons les compétences indispensables à la bonne marche d’une société complexe », diagnostique l’auteur.
Pourtant, en se référant à Erikson, il souligne combien la conscience de soi émerge dans le cadre de l’expérimentation et de la communication avec les autres.
Coopération façonnée
La prise de conscience des autres se produit dans la tête du citadin et Sennett souligne que « sauver la face est un rituel de coopération » commun qui permet aux forts et les faibles de se retrouver dans un code d’honneur commun.
Selon l’auteur, ce qui compte dans les relations sociales, c’est l’expérience ordinaire. Faisant lien avec son précédent ouvrage, il célèbre alors les solidarités d’atelier, nées il y a six mille ans en Mésopotamie, où l’on conseille plus qu’on dirige. Dans ce contexte, la coopération s’appuie sur des « rituels vivants ». C’est pourquoi, à la suite de l’historien Keith Thomas, il emploie le mot enactment – « énaction »- plutôt que « présentation de soi » pour décrire l’extériorisation à l’œuvre dans les rituels ».
Parmi ces rituels, Sennett s’intéresse à la propagation du langage diplomatique qui représenta un changement de fond dans la sociabilité par le passage de la chevalerie à la civilité, au XVIème siècle. Elle se manifeste très tôt par ce que l’on nomma la sprezzatura, c’est-à-dire une certaine désinvolture cachant l’effort et favorisant la sociabilité par un « moi plus discret » allégeant la pression dans les négociations. Parallèlement, la courtoisie marqua un changement profond dans la civilisation. La clé de ces changements réside dans la maîtrise du corps et des comportements dans un large mouvement réprouvant la spontanéité : « plus qu’un trait de personnalité, la civilité est un échange dans lequel les deux parties veillent à ce que la rencontre soit mutuellement plaisante ». Et, bien évidemment, la diplomatie fit de ces codes naissants un usage professionnel : évitement du triomphalisme, expression sur un mode subjonctif, gestion du silence.
Triangle social
À rebours de cette évolution, les sociétés américaine et européenne actuelles, « ont moins de cohésion qu’elles n’en avaient ne serait-ce qu’il y a trente ans, moins de confiance dans les institutions, et moins de confiance dans les leaders (…) les gens « hibernent » et la participation passive est désormais la marque de la société civile ».
Sennett compare cet état de fait avec la Chine. Devenue agressivement capitaliste, elle a cependant su conserver son code de cohésion sociale, le guanxi, un réseau relationnel complexe, cultivé avec subtilité et qui renvoie à une notion de Devoir ou d’Honneur. Même si les membres du réseau se chamaillent, ils se sentent obligés d’être secourables. C’est là un lien durable dans lequel un service rendu en appelle un en retour, à long terme, dans le cadre d’un lien prolongé de génération en génération. Et, une personne qui se refuserait à solliciter de l’aide serait considérée comme affectée d’une lourde tare constitutive d’une peur d’être insérée dans la société.
Dans nos contrées, où l’inégalité est intégrée dès l’enfance avant de se rejouer à travers la consommation, la comparaison envieuse exploite le complexe d’infériorité de gens ordinaires, lesquels n’éprouvent pas le sentiment d’obtenir une reconnaissance et cultivent une piètre estime d’eux-mêmes. Cet état de fait rompt avec le mode de relation qui assurait la stabilité de la civilisation industrielle dont Sennett considère qu’il formait un « triangle social » : d’un côté une autorité acquise par les patrons corrects ; d’un autre un respect mutuel entre les salariés partageant la même vie ; et, enfin, la coopération quand survenait une crise (soutien entre salariés, engagement pour faire face aux pannes…).
Aujourd’hui, l’économie se trouve surtout animée par une industrie financière, « activité de grand stress, qui astreint les gens à de très longues heures de travail au point de sacrifier les temps pour les enfants, les conjoints et les plaisirs de la vie sociale ». Après la crise, ils sont très amers d’avoir joué le jeu de l’industrie financière à ses conditions à elle. Ils ont compris combien ils avaient peu de respect pour leurs anciens dirigeants, combien la confiance dans leurs collègues de travail était superficielle et à quel point la coopération s’était révélée faible.
Solidarités feintes
De surcroît, pour que le triangle social puisse se rétablir, il faudrait des institutions relativement stables, ce qui est rarement le cas dans les formes récentes du capitalisme que Bennett Harrison nomme le « capital impatient ». « Le court terme a restructuré la nature même du travail, analyse Sennett. De nos jours, le marché du travail a remplacé les carrières durables par des tâches à court terme. (…) Même s’il est employé à plein temps, le jeune diplômé de niveau moyen peut s’attendre à changer au moins douze fois d’employeur au cours de sa vie active et à changer au moins trois fois sa « base de compétence » ; celles dont il a besoin à quarante ans ne sont pas celles qu’il a acquises à l’école ».
Autrement dit, « au cours de la longue période d’expansion de la finance, la stabilité est devenue un stigmate ».L’isolement s’est installé, dans un contexte d’effets silo. Or, il est l’ennemi évident de la coopération. Quant au travail en équipe prévalant actuellement dans les entreprises, « il implique un comportement social transportable que les membres de l’équipe devraient pouvoir pratiquer n’importe où et avec n’importe qui ». Se développent donc des « solidarités feintes ».
Autre effet du travail contemporain : le leadership abdique de l’autorité, sans pour autant renoncer au pouvoir ou aux avantages. Il demande des reportings simplifiés sans chercher à s’investir dans le travail réel des strates inférieures. D’où l’extension des angoisses de rôles provenant de situations dans lesquelles les gens jouent les rôles qui leur sont attribués tout en doutant d’eux-mêmes ou encore de phénomènes marqués de dissonance cognitive. Pourtant, la réduction de l’angoisse passerait par la neutralisation des stimulations, donc l’ennui, l’apathie, le retrait, voire la dépression.
Incorporation de la relation
Le travail physique traditionnel, instille, pour sa part, un comportement social dialogique. « Le processus se produit dans le corps des artisans ; dans le jargon des sciences sociales, on établit un lien entre le physique et le social en employant l’affreux mot d’embodiment, « incorporation ». « Montrer passe avant expliquer » et les gestes « informels rattachent et lient les gens émotionnellement ».
Dans le travail manuel, la solution la plus efficace consiste à recourir à la force minimale nécessaire pour réaliser l’opération (ex. compter sur le poids du marteau plus que sur la force du bras). Cette approche de la résistance s’impose dans le comportement social dialogique : il faut éviter l’excès d’aplomb et, dans un jeu à somme nulle, il faut veiller à ce qu’il restera au perdant pour qu’il puisse rejouer et que l’échange se poursuive.
Ces expériences conduisent à une « diplomatie quotidienne » qui « est une façon pour les gens de faire face à une chose qu’ils ne comprennent pas, avec laquelle ils ne peuvent établir de rapports ou sont en conflit » ; leurs « efforts reposent sur la suggestion plutôt que sur le commandement » qui fait progressivement entrer la part de l’autre dans le raisonnement, à la façon socratique.
Ces différents codes de civilité substituent la discussion au conflit ouvert. Se pourrait-il alors que la coopération constitue une nouvelle stratégie de résistance face aux emportements de l’économie mondialisée ?




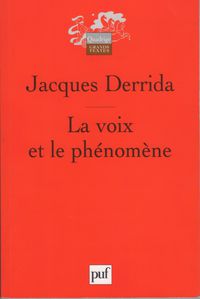 Jacques Derrida
Jacques Derrida


 Il suffit d'un geste
Il suffit d'un geste Christophe André
Christophe André Méditer, jour après jour - 25 leçons pour vivre en pleine conscience
Méditer, jour après jour - 25 leçons pour vivre en pleine conscience Savoir attendre pour que la vie change
Savoir attendre pour que la vie change Sur le chagrin et sur le deuil
Sur le chagrin et sur le deuil/image%2F1419864%2F20150221%2Fob_6d8508_14-01-p-lamarque-2-copie.jpg)